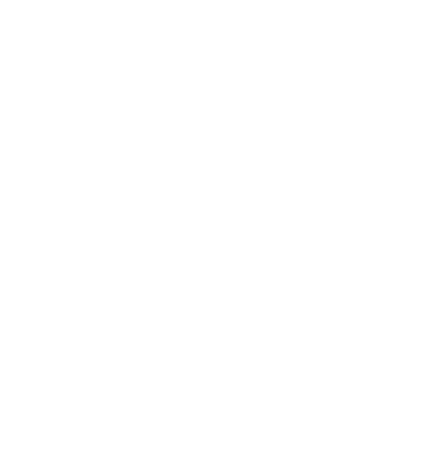Carte Blanche • Sébastien Éveno
Propos recueillis par Arnaud Maïsetti
Entretien brut
Voilà, ça marche… On pourrait commencer… Je ne sais pas, j’avais imaginé plusieurs choses. Peut-être, partons de là : comment se passent les journées pour toi ? Comment ça se rythme, ça ressemble à quoi ces journées de Mousson ?
Comme à chaque fois… Moi, j’arrive toujours, comme tous les acteurs pratiquement, une semaine et demie avant tout le monde. Au début, ça va, et puis, évidemment, plus ça avance, plus ça se resserre, et quand on arrive à trois services, là, c’est compliqué, oui.
Cette année, je n’ai que trois textes à défendre, parce que je joue aussi dans un spectacle. Donc je peux voir quand même certaines lectures, mais je vois des gens comme Céline, qui a quatre textes plus des cabarets et tout… Ce sont des Moussons où tu n’es même pas spectateur de quoi que ce soit. Ça m’est arrivé : j’ai fait des Moussons où je n’ai absolument jamais vu un seul texte de mes camardes.
Après, ce sont des enjeux différents, non ? Spectateur, acteur… Est-ce que ce n’est pas plus difficile d’être… Tu es aussi là pour ça, pour découvrir des textes ?
Oui. C’est quand même ça… Et puis quand tu vis avec d’autres gens pendant plus de quinze jours, c’est bien de voir aussi le résultat des autres, pas seulement de jouer.
Et puis tu es au Comité de lecture aussi…
Oui, le fait de lire, de découvrir des textes ça m’intéresse, ce n’est pas juste de jouer… Mais bon, cette année, je n’ai vu que quelques lectures, pas assez évidemment. Mais c’est vrai que c’est un travail différent d’être spectateur et d’être acteur. Par exemple, sur Nocturne de Mayenburg, je l’avais lu au comité de lecture, et le fait de le ressentir de l’intérieur, par le avec le corps, c’est complètement différent. On voit plus de choses, on en découvre davantage. C’est pour ça que ça m’intéresse le texte contemporain – ça fait un moment que j’en lis. Après, il y a des textes qui, à la lecture, paraissent très intéressants, et puis, à le travailler, ça se s’assèche, bizarrement. Et d’autres, au contraire, qui paraissent obscurs mais qui prennent de l’ampleur ensuite. Mais ça fait partie du travail. Je me souviens par exemple de Insoutenables longues étreintes de Viripaëv, qui avait été lu ici. J’ai eu la chance de travailler dessus avec Galin Stoev et de le monter. À la lecture, c’était très obscur. J’avais même dit à Galin que je n’y arriverais pas, que je n’étais sans doute pas le bon acteur pour ça. Et ça a mis du temps – ça m’a mis deux mois pour vraiment comprendre. De toute façon, le travail de l’acteur, c’est ça : essayer de comprendre l’énergie de l’écriture. C’est ce que Régy disait – chaque écrivain a sa propre énergie d’écriture, et l’acteur doit juste essayer de la trouver. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. De découvrir l’énergie de la naissance de l’écriture chez chacun, et ça ne se donne pas facilement. C’est aussi physiquement : comment tu trouves physiquement l’énergie de l’écriture ?
L’acteur, il a son énergie propre, aussi ?
Oui, mais justement, il doit mettre son ego de côté. Ce n’est pas le travail de l’acteur de se mettre en avant. Absolument, on dit toujours ça : il y a des acteurs qui font toujours la même chose, quel que soit le texte. Oui, mais ce n’est pas mon cas. Ce n’est pas ma définition du métier d’acteur, et ce n’est pas mon travail. Sans dénigrer ceux qui travaillent comme ça – mais si quand même, ils ne m’intéressent pas. Pour moi, l’acteur doit se mettre au service de l’écriture et chercher l’énergie pour chaque texte. Là, par exemple, j’ai une autrice colombienne, un auteur québécois, un auteur allemand à défendre… et chacun a son énergie propret, et il faut trouver l’énergie de l’écriture. C’est un travail vraiment spécifique d’essayer de trouver cette énergie.
Et ça se passe comment le choix des textes ? Tu disais « défendre un texte » : comment ça se décide, d’être dans tel ou tel texte ? C’est toi qui choisis ?
Pas du tout. Que ce soit pour les metteurs en espace, les lectures ou les acteurs, c’est la directrice, Véronique Bellegarde, qui décide. Moi, je fais partie du comité de lecture, donc on lit énormément de textes sur un an. Mais au final, c’est elle qui tranche. Donc quand j’arrive ici, je ne sais pas toujours si j’ai déjà lu les textes ou pas. Cette année, j’en avais lu un seul, Nocturne. Les autres, non. Et souvent, c’est comme ça. On reçoit les textes en juillet, avec les rôles, et c’est pareil pour les metteurs en espace : ils ne décident pas des textes ni de la distribution. Et je trouve ça bien, de ne pas choisir. Parfois, ça tombe juste, parfois c’est plus compliqué, mais justement : l’intérêt, c’est de chercher et de défendre l’énergie de l’écriture, même si le texte nous paraît moins intéressant au départ.
Et ça se passe dans un temps très resserré – comment vous faites ? Tu fais confiance à tes intuitions ? Ou tu essayes des choses différentes à chaque service ? Comment on trouve l’énergie d’un texte ? Tu te fais confiance d’emblée ?
Oui, il faut se fier d’emblée à la première lecture à voix haute. Souvent, entre ce qu’on imaginait tout seul dans le train ou dans sa chambre, et ce qu’on découvre à voix haute avec les autres, soudain, c’est très différent. Le sens s’éclaire, assez mystérieusement d’ailleurs. Et après, il faut faire confiance aux indications du metteur en espace. Même pour mise en scène, de l’intérieur, on n’a pas souvent les bons choix, on n’est pas forcément les bons juges pour savoir ce que ça produit. Je le dis souvent aux jeunes acteurs qui disent qu’ils ressentent pas un texte : entre ce que vous ressentez et ce que ressent le public, c’est souvent pas du tout la même chose, et quelque part, on s’en fout de ce que vous ressentez : l’important, c’est ce que ça produit chez le spectateur. Si vous ressentez rien et que le public ressent quelque chose, c’est le principal. On n’a pas à ressentir quelque chose. En tous cas, c’es tel metteur en espace, qui souvent est très clairvoyant, et qui lui nous donne des pistes… Dans un temps si resserré, on n’a de toute manière pas le temps d’avoir le temps – bien sûr, on a des intuitions, mais il faut pas essayer d’anticiper, donc il faut se faire confiance, et c’est sur l’instant, essayer des choses, essayer, prendre une piste et voir, de se lancer, sans se juger. Bien sûr, il y a des acteurs qu’on ne connaît pas, d’autres qu’on connaît, mais en tout cas, il ne faut ni s’autocensurer, ni se regarder jouer. On n’a pas le temps. Et c’est ça qui est superbe dans ces Moussons : dès la première que j’ai faite, ça m’ tout de suite plu. Parce qu’on n’a pas le temps de se poser les mauvaises questions, de se regadrer, de s’autojuger. L’ego de l’acteur n’a pas de place ici, parce qu’on n’a pas le temps pour ça. Donc il faut se lancer. Ne pas se regarder. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Si ça se tend un petit peu, il faut savoir retenir. Mais il n’y a pas de stress à avoir…
C’est donc un peu une école, alors, encore ici ?
Complètement. Et je vois des jeunes acteurs qui font ça pour la première fois, et qui veulent « montrer » quelque chose d’eux-mêmes, mais non ; et du coup ils apprennent quelque chose, d’être dans une détente ; qu’il faut juste se mettre au service du texte. Si on essaie de prouver quelque chose à ceux qui nous regardent, ça ne marche pas du tout. Il ne faut pas chercher à être efficace ou plus drôle que celui qui est à côté.
Et pour toi, la Mousson, dans l’année, c’est quoi ? Une parenthèse, une rampe de lancement, ou un temps comme les autres ?
Pour moi, dans la vie d’un acteur, de la mienne en tous cas, c’est pratiquement le début de saison, c’est comme un lancement tout en douceur. Et puis ça remet les choses d’équerre. Le fait de ne pas avoir le temps, ça simplifie, ça détend, et ça remet le travail au bon endroit. Ce n’est pas des vacances, mais ça me permet d’entrer dans le très d’une année bien chargée de façon assez joyeuse. Parce qu’aussi il y a une camaraderie assez joyeuse entre acteurs, metteurs en scène… ça nous permet de nous rencontre d’une façon détendue, on n’est moins dans le stress d’une création, parce qu’une création, déjà, ce sont deux mois de répétitions, avec forcément des tensions, et le stress du regard de la presse, du public, des pairs. Ici, il y a quelque chose de plus détendu, et qui permet de rencontrer des metteurs en scène qui sont par ailleurs moins accessibles tout au loin de l’année ; là on se parle de façon plus simple, tout est plus simple.
Pour terminer, est-ce qu’il y a une image de la Mousson qui te reste ? Une scène, un fragment, quelque chose ?
Ça peut être les soirées, les fêtes… Mais c’est surtout deux auteurs, que j’ai eu la chance de rencontrer et dont j’ai pu créer les spectacles après une lecture ici : Magne van den Berg et Fredrik Brattberg. Avec Carole Thibault, on avait lu deux textes de Magne ici, qu’on a ensuite pu créés chez elle à Montluçon. Et puis un autre, Sur la Côte Sud, lu par Véronique, qu’un metteur en scène est venu voir et qu’il a monté et que j’ai eu la chance de le jouer. Ça, ce sont de belles choses : que les lectures deviennent des spectacles, qu’elles aient une autre vie. Ce sont les plus belles choses qui puissent arriver ici, et et ça arrive souvent. Par exemple Insoutenables…, je ne l’ai pas joué ici, mais il a été lu pour la première fois à la Mousson, mais ensuite, je l’ai joué avec Galin Stoev – mais c’est né ici. Il y asu plein d’auteurs qui sont nés ici. Et découvrir leurs textes sur scène, c’est ce qu’il y a de plus beau.
Eh bien superbe, merci…
J’espère qu’on n’a pas dit trop de conneries.
Mais non ! J’arrête là l’enregistrement…
ENTRETIEN PUBLIÉ
Être acteur, pour moi, c’est d’abord se mettre au service de l’écriture. Chaque auteur possède une énergie propre, singulière, et tout notre travail consiste à essayer de la recevoir, la ressentir, et la faire passer. Ce n’est jamais immédiat, jamais facile : certains textes paraissent limpides à la lecture et s’assèchent une fois travaillés ; d’autres semblent obscurs et se révèlent peu à peu. Je pense à Insoutenables longues étreintes de Viripaëv. Au début, je n’y arrivais pas, j’étais persuadé de ne pas être le bon acteur pour ce texte. Et puis, à force d’y revenir, quelque chose s’est ouvert. C’est ça, le chemin de l’acteur : découvrir l’énergie de la naissance de l’écriture et tenter de s’y accorder. Cela demande du temps, de l’écoute et surtout de l’humilité. L’acteur a sa propre énergie, bien sûr, mais il doit mettre son ego de côté. Je n’ai jamais été intéressé par ceux qui, quel que soit le texte, rejouent toujours la même partition. Le métier, tel que je le conçois, n’est pas de se montrer, mais de se laisser traverser. Chercher, pour chaque auteur, l’énergie singulière de son écriture : voilà ce qui m’anime.
À la Mousson, cette exigence est centrale. Le temps y est resserré, on n’a pas le luxe de se perdre dans des hésitations ou de s’observer. Dès la première lecture à voix haute, le sens se déplace, s’éclaire, assez mystérieusement d’ailleurs. Alors il faut faire confiance : aux intuitions, aux partenaires, aux metteurs en espace, qui souvent voient plus clair que nous. Je le répète souvent aux jeunes acteurs : peu importe ce que vous ressentez. Ce qui compte, c’est ce que le spectateur reçoit. On peut ne rien éprouver et pourtant transmettre une émotion forte. L’essentiel est là.
Dans ces conditions, l’ego de l’acteur n’a pas sa place. Pas le temps de s’autojuger, pas le temps de chercher à être plus drôle, plus efficace que l’autre. Il faut simplement essayer, se lancer, prendre une piste et voir ce qui se passe. C’est pour cela que j’ai aimé la Mousson dès ma première venue ici : on n’a pas le temps des mauvaises questions. On travaille dans l’urgence, et c’est cette urgence qui fait naître l’essentiel.
De ce point de vue, la Mousson est une école. Les jeunes acteurs qui arrivent veulent souvent « montrer » quelque chose d’eux-mêmes. Mais ils découvrent vite que ce n’est pas le lieu pour ça. Ici, on apprend la détente, la mise en retrait, le service du texte. C’est une leçon précieuse : on ne prouve rien, on cherche, on s’abandonne à l’écriture.
Chaque fin d’été, pour moi, la Mousson est comme un seuil. Elle ouvre la saison, remet le travail au bon endroit. Ce n’est pas un temps de vacances, mais une manière joyeuse d’entrer dans une année toujours chargée. Et puis, il y a la camaraderie entre acteurs, les rencontres avec les metteurs en scène, une légèreté qui contraste avec le poids des créations. On se retrouve, on s’écoute, on partage dans une simplicité qui est devenue rare.
De ces années à la Mousson, je retiens la rencontre avec deux auteurs – que j’ai eu la chance de rencontrer et dont j’ai pu créer les spectacles après une lecture ici : Magne van den Berg et Fredrik Brattberg. Que les lectures deviennent des spectacles, qu’elles aient une autre vie. Ce sont les plus belles choses qui puissent arriver ici. Plein d’auteurs sont nés à la Mousson, et découvrir leur textes ici avant qu’ils deviennent des spectacles, c’est ce qu’il y a de plus beau.
Vous aimerez aussi

L’Université d’été 2016
4 janvier 2016
La Mousson d’hiver 2016
29 décembre 2015