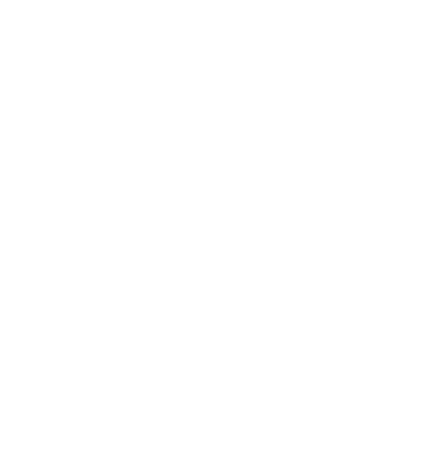« Bleach Me », Nalini Vidoolah Mootoosamy • Entretien avec l’autrice
« Transmettre l’appartence dans un monde divisé »
Peux-tu présenter ton parcours d’autrice ?
« Il n’y a pas de hasards », tel est le titre du livre de Robert H. Hopcke. Je le cite parce que, instinctivement, mon parcours d’autrice pourrait sembler être le fruit du hasard, mais ce n’est pas le cas.
Une petite introduction pour dire que je n’ai pas fréquenté d’écoles de théâtre et que je suis parvenue à l’univers théâtrale en faisant un long détour. J’ai fait un doctorat en littérature française et j’ai enseigné plusieurs années à l’université, avant que le théâtre ne s’impose avec force dans ma vie.
Tout est né d’une série de circonstances synchroniques qui m’ont indiqué la voie à suivre. Un ami auteur et metteur en scène m’avait invitée aux répétitions d’un spectacle qui abordait des thèmes liés à notre contemporanéité.
Ce fut un véritable coup de foudre.
Je ne connaissais pas le théâtre contemporain : pour moi, le théâtre, c’était Shakespeare, Goldoni, Beckett, Tchekhov et – grâce à mes études universitaires – surtout des auteurs français comme Molière, Racine, Ionesco, Giraudoux, Sartre, Camus. Dans ma bibliothèque, les textes de théâtre français occupent la majeure partie de l’espace.
En fait, au lieu de voir jouer les pièces sur scène, je les lisais. Je n’ai pas eu, dans ma jeunesse, beaucoup d’occasions ni de moyens pour vivre le théâtre en direct.
Ces répétitions ont été décisives : elles m’ont permis de revenir sur la voie principale. Neuf ans se sont écoulés depuis. Pendant cette période, je me suis formée en suivant des cours et en choisissant presque tout de suite d’approfondir l’écriture théâtrale, car elle me permettait de donner corps et espace tridimensionnel aux images que j’avais en tête.
En parallèle, j’ai expérimenté le théâtre dans plusieurs directions, m’occupant du jeu, de la mise en scène, de la scénographie, des lumières. Dans le milieu théâtral, on dit que pour bien écrire pour le théâtre, il faut savoir un peu tout faire ; je l’ai pris au pied de la lettre.
J’ai aussi eu de la chance. Sur mon chemin, j’ai rencontré plusieurs alliés (parmi lesquels Fabulamundi) : des réalités et des personnes attentives à la dramaturgie contemporaine, qui m’ont aidée à faire émerger mon écriture. Un phénomène loin d’être simple en Italie : les raisons sont multiples, notamment la discrimination raciale et de genre.
Penses-tu pouvoir écrire sans le théâtre ?
L’écriture est pour moi un mode de vie, un souffle.
Depuis ma jeunesse, j’ai toujours été un peu graphomane, peut-être pour mettre de l’ordre dans mes pensées confuses ou pour compenser ma difficulté à communiquer avec les autres. Je remplissais des pages et des pages « d’impressions de vie » et de récits brefs que je n’ai cependant jamais eu le courage de partager, par crainte du jugement des autres.
Ces récits ont malheureusement été perdus. Je les avais « sauvegardés » sur un ordinateur qui est tombé en panne, sans possibilité de récupérer les données. J’ai vécu ce petit choc comme un signe et j’ai cessé d’écrire pour moi-même, me consacrant à des critiques, des essais ou des articles universitaires. Une écriture formelle mais dépourvue d’introspection.
Puis le théâtre est entré dans ma vie. Avec le théâtre est arrivé aussi le courage de partager mon monde intérieur. Ce fut un retour lent mais inévitable à la fiction. Un exercice de style entre l’écriture théâtrale et la prose. J’aime passer de l’une à l’autre, mais surtout, j’adore les mélanger.
Je pourrais peut-être écrire sans le théâtre, mais je sais bien que sans le théâtre, je n’aurais peut-être jamais trouvé ma voix.
Peux-tu expliciter ce que le théâtre apporte à ton entreprise d’écriture ?
J’ai commencé à écrire dans la solitude, mais le théâtre m’a fait découvrir une nouvelle dimension de la parole. Dans l’œuvre narrative, les phrases restent immobiles sur la page blanche, et ce « noir sur blanc » m’a toujours mis un peu mal à l’aise. L’écriture théâtrale, en revanche, est vivante : elle bouge, elle évolue, elle agit à travers les acteurs/actrices et atteint les spectateurs.
Ce flux continu me galvanise. Rien n’est définitif, tout peut changer. Mon texte passe par le corps et la voix des interprètes, s’entremêle avec le regard du metteur en scène, se colore de lumières et de musiques. Il se transforme j’jusqu’à devenir quelque chose qui ne m’appartient plus entièrement et, précisément pour cette raison, il s’enrichit et me libère. Je peux écrire en sachant que, pendant les répétitions, une phrase peut se transformer ou s’améliorer. Le théâtre permet de raconter non seulement à travers les mots, mais aussi avec tout ce qui les entoure : les pauses, les silences, les gestes, les souffles. C’est un langage tridimensionnel, où l’écriture n’est que le début d’un parcours partagé.
Peux-tu présenter ta pièce et ses enjeux sans trop la « divulgacher » ?
Bleach Me raconte l’histoire d’Ada, une jeune scientifique noire née et élevée dans un pays occidental, qui découvre qu’elle attend un enfant de son compagnon blanc. Cet événement imprévu ravive en elle d’anciennes peurs : elle craint de ne pas pouvoir protéger l’enfant du racisme qui l’a marquée depuis son enfance. Rassurée par son compagnon, Ada décide de mener sa grossesse à terme, mais la naissance d’une petite fille, étonnamment blanche, déclenche une nouvelle spirale d’incompréhensions, de conflits et de préjugés, tant au sein de la famille qu’à l’extérieur. Le conflit avec sa mère, migrante de première génération qui tente par tous les moyens de transmettre à Ada l’histoire, les traditions et les pratiques spirituelles du Nigeria, est particulièrement évident, tandis qu’Ada s’obstine à embrasser le modèle rationnel eurocentré.
Entre convictions opposées, héritages coloniaux, amour maternel et fragilités personnelles, les trois personnages sont confrontés à une question qui traverse toute la pièce : comment transmettre l’identité et le sentiment d’appartenance dans un monde divisé par des frontières raciales persistantes ?
Bleach Me est une pièce très intime qui met en scène le corps, la couleur de la peau, les relations pluriethniques complexes et le lien entre les générations comme lieux de résistance, de conflit et de transformation.
Dans quel contexte ce texte a-t-il été écrit ?
J’avais depuis longtemps en tête d’écrire une pièce liée à la pratique du blanchiment de la peau par de nombreuses femmes en Afrique, en Asie ou en Amérique latine à l’aide de produits cancérigènes, afin de refléter les normes de beauté mondialisées.
Je voulais explorer les racines coloniales et culturelles qui poussent ces femmes à mettre leur santé en danger et, en même temps, mettre en évidence les traumatismes du racisme intériorisé.
Quand on m’a demandé de présenter un texte pour une émission de radio en Italie, j’ai instinctivement décidé de poursuivre cette histoire.
Je ne voulais cependant pas aborder la question de manière directe et didactique, mais chercher une perspective narrative plus intrigante. J’ai donc relu pour la énième fois Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon. C’est un texte que j’ai découvert pendant mes années universitaires. Je le trouve éclairant et terriblement actuel sur les questions d’identité raciale et même de genre, surtout lorsqu’il parle de la nécessité de « libérer l’homme noir de lui-même ».
Pourquoi et comment ces questions de racisme et de maternité ont-elles nourri ton écriture ?
Je vis en Italie depuis longtemps et, au fil des ans, j’ai pu observer les dynamiques relationnelles très complexes entre les personnes blanches et non blanches. Je n’utilise pas le mot « noir », car ce n’est pas seulement une question de couleur de peau, mais aussi d’origines ethniques, de toutes les personnes qui ne sont pas immédiatement perçues comme italiennes.
Malheureusement, l’Italie a beaucoup de mal à se reconnaître raciste. Quand on parle de racisme, les gens soupirent ou nient l’évidence. C’est une attitude que j’ai découverte être à la mode dans d’autres pays également, comme le dénonce l’écrivaine britannique Reni Eddo-Lodge dans son livre Le racisme est un problème de Blancs, dont le titre original en anglais est Why I’m No Longer Talking to White People About Race.
La lecture de ce livre sur le phénomène de racisme structurel m’a amenée à me poser beaucoup de questions et je me souviens avoir pensé : « Mais si une femme noire donne naissance à un enfant blanc, aurait-elle les mêmes difficultés à lui parler de racisme ? ».
Je me suis alors souvenue d’un fait divers qui s’était produit à Palerme, la ville où j’ai grandi. Une femme nigériane avait donné naissance à un enfant blanc, aux cheveux roux et aux yeux clairs – peut-être un cas d’albinisme ou de mutation génétique – et son mari, convaincu d’avoir été trompé, était devenu fou de rage. Laissant de côté le cas de l’infidélité, j’ai pensé à ce que cette femme avait dû ressentir en mettant au monde un enfant blanc. Car c’est une chose pour une femme noire d’être en couple avec un homme blanc, mais c’en est une autre de donner naissance à un enfant blanc. Ce fut mon point de départ pour explorer ce nouveau lien lié à la maternité sous l’angle du racisme intériorisé.
Je tiens à préciser que je ne suis pas quelqu’un qui justifie chaque injustice subie ou vécue comme un acte de racisme. J’essaye d’être très lucide à ce sujet et de comprendre la frontière entre ignorance, méfiance et racisme. Mais plus j’avance, plus je me rends compte, surtout à cause de l’absence de politiques d’intégration et de la propagande anti-immigration en Italie, que la cohabitation entre Blancs et non-Blancs devient de plus en plus tendue. Désormais, les incidents de violence et de haine raciale – au stade comme dans la rue – sont désormais quotidiens.
J’en ai moi-même été victime. Ce sont des incidents qui m’ont marquée et que je porte avec moi. Ce sont des incidents qui, peut-être autrefois, seraient passés sous silence, mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas.
Il y a de nouvelles générations d’Italiens avec un background migratoire qui ont commencé à faire entendre leurs voix à ce sujet. J’aime penser que je fais partie de ce petit chœur, à ma manière. Si j’écris, c’est aussi pour cette raison : pour mettre en lumière le problème, dans l’espoir de rapprocher ce qui semble encore aujourd’hui inconciliable.
Peux-tu expliquer le lien particulier que tu entretiens avec Véronique Bellegarde et la Mousson ?
J’ai fait la connaissance de Véronique Bellegarde et de la Mousson grâce au réseau PAV-Fabulamundi, auquel je suis affiliée. Nous nous sommes rencontrées pour la première fois l’année dernière à Paris, plus précisément le 4 mars : je m’en souviens bien car c’est précisément ce jour-là que la France a inscrit dans sa Constitution le droit à l’interruption volontaire de grossesse. En y repensant aujourd’hui, je souris : il y a là une certaine synchronicité, étant donné que Véronique et moi travaillons justement sur Bleach Me, une pièce qui traite également de la grossesse non désirée.
Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet européen PLAYGROUND, une collaboration entre PAV-Fabulamundi, la Mousson d’été et trois autres partenaires en Italie, en Serbie et en Roumanie. L’objectif du projet est de traduire un texte et de le tester sur scène à travers une confrontation directe – dans notre cas, entre moi, la metteuse en scène Véronique Bellegarde, la traductrice Federica Martucci et les trois comédiens : Astrid Bayiha, Matisse Humbert et Cindy Vincent.
En juin, nous avons effectué une résidence d’une semaine et, sous le regard attentif de Véronique, nous avons pu vérifier non seulement l’efficacité de la traduction, mais aussi la tenue du texte, notamment dans le contexte français. La pièce en est ressortie enrichie. La version que nous présentons à la Mousson est le fruit de ces journées de travail et des précieuses suggestions qui ont émergé pendant la résidence.
Vous aimerez aussi

L’Université d’été 2016
4 janvier 2016
La Mousson d’été 2016
29 décembre 2015