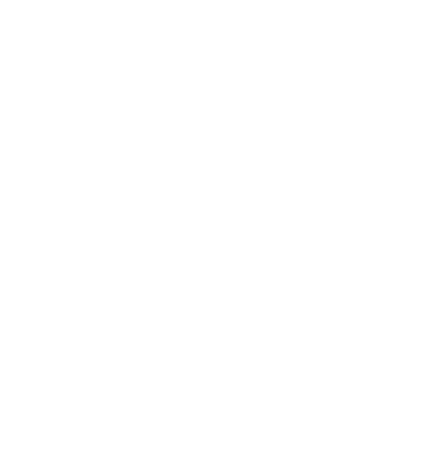« Le Papa, la Maman, et le Nazi » de Bruno Mistiaen • Entretien avec Sofiane Boussahel, traducteur

« J’ai beaucoup hésité à traduire ce texte »
Cette traduction, Le Papa, la Maman et le Nazi, est une commande de Flanders Literature et du Fonds Podiumkunsten NL dans le cadre du projet Ivre de mots, qui sera présenté à la Mousson le 22. la Maison Antoine Vitez est partenaire du projet. Toutes les pièces traduites dans ce cadre, de Belgique et des Pays-Bas, ont intégré le catalogue en ligne de la MAV et sont présentées dans la brochure Ivre de mots éditée par la MAV. La brochure sera présentée elle aussi le 22.
J’ai répondu à l’appel de Flanders Literature (le fonds de soutien flamand à la littérature et à la traduction, ce qui inclut aussi les textes dramatiques) en traduisant le texte qu’on m’a proposé, celui de Bruno Mistiaen, auteur que je connaissais déjà de nom.
Dans la brochure Ivre de mots qui sera présentée le 22, deux textes figurent en intro, un sur les écritures dramatiques de Flandre et un autre sur les écritures dramatiques des Pays-Bas, je les ai traduits pour la MAV en collaboration avec Lola Bertels, la traductrice flamande qui a été ma co-traductrice sur un autre texte (de l’auteur flamand Freek Mariën) et avec qui j’ai d’autres projets de traduction théâtrale, car c’est génial de traduire en binôme 1 personne qui a la langue cible pour langue maternelle, une personne qui a la langue source pour langue maternelle, de surcroît quand on se confronte à une écriture dramatique reposant sur une langue très orale.
Je traduis le néerlandais et l’allemand. J’ai choisi le néerlandais tout naturellement par proximité géographique (je suis du Nord, né en Flandre française). L’allemand a été un autre coup de foudre, mais différent. Dans tous les cas, l’approche culturelle est différente, car si les deux langues ont une racine commune (le néerlandais est infiniment plus proche de l’allemand que le sont les langues scandinaves, évidemment), le rapport à la culture et à la langue, l’esprit de la langue n’ont vraiment rien à voir.
Ce qui est séduisant dans les écritures dramatiques de Flandre et des Pays-Bas, ainsi que l’auront compris les spectateurices de la Mousson, c’est cette langue cinglante, incisive, les répliques brèves et l’économie des moyens textuels. Tout cela est très bien expliqué dans les textes d’introduction de la brochure Ivre de mots.
Le texte de Bruno Mistiaen est cependant un peu à part, il a recours à une langue volontairement fleurie, ampoulée, c’est un des ressorts de l’humour du texte, un humour très décalé, une caractéristique qu’on associe souvent en France à l’humour belge.
J’ai beaucoup hésité à traduire ce texte, j’ai été gêné par l’humour sur le nazisme et sur la persécution des Juifs. Je me suis demandé comment cela allait être perçu par les comités de lecture en France. Je suis très prudent avec ce genre d’humour (qui par ailleurs n’est pas vraiment le mien). Mais quand on est germaniste et néerlandiciste, l’extrême-droite, le retour du refoulé, la tentation fasciste, le devoir de mémoire, le tabou qui pèse encore sur certains sujets (y compris en Allemagne) sont des thématiques incontournables (cf. à ce sujet les deux ouvrages remarquables d’Olivier Mannoni sur son expérience de traduction de Mein Kampf et sur la manipulation du langage par le nouveau populisme). Après coup, le travail de Bruno Mistiaen m’est apparu extrêmement fin, malgré le côté choquant, grinçant, violent de son humour. Il dénonce le processus d’embrigadement dans une farce qui se révèle être une pièce d’une profonde tendresse (le personnage de la mère, le renversement de situation à la fin, ce que la pièce dit sur les liens familiaux sont très touchants).
Pour me présenter : je n’allais pas voir le théâtre dramatique avant 2015, quasiment pas. J’allais plutôt à l’opéra (ma formation est d’abord musicale). Je me suis surtout intéressé aux textes allemands, car j’habitais une ville, Luxembourg, où je pouvais facilement aller voir du théâtre en allemand, l’époque où attiré par la traduction littéraire, j’ai décidé de m’y consacrer (j’ai traduit depuis des ouvrages sur la musique, de la philo, des sciences humaines, des écrits de compositeurs, de la fiction).
C’est la Maison Antoine Vitez qui m’a permis de me former à la traduction théâtrale : 1. grâce à l’atelier de traduction TheaterTransfer français/allemand à Sarrebruck en 2017 en marge du festival Primeurs (qui comme la Mousson s’investit beaucoup dans la promotion de textes traduits, en l’occurrence du français vers l’allemand). 2. grâce à un atelier de traduction théâtrale néerlandais-français (organisé avec les partenaires flamands et néerlandais cités plus haut) à la Charteuse à Villeneuve-lès-Avignon en 2019.
C’est à Sarrebruck en 2017 que j’ai entendu parler de la Mousson et j’ai participé pour la 1re fois à l’Université d’été en 2018 !
Ce qui est très chouette, aussi, avec la Maison Antoine Vitez, c’est qu’on reçoit les conseils des comités de chaque langue sur les traductions que l’on propose pour le palmarès annuel de l’aide à la traduction. Cela permet de se former.
L’important, avec la traduction théâtrale, c’est d’aller au théâtre (peut-être aussi d’en faire, quand on s’en sent la capacité et l’envie, qu’on en a le temps), se familiariser avec le plateau et avec les écritures dramatiques (et pour cela la Mousson est un laboratoire extraordinaire). Il est possible que le plus gros contresens qu’on puisse faire en tant que traducteur de théâtre n’est peut-être pas de n’avoir pas tout à fait compris le sens de telle ou telle expression (pour éviter cela, on travaille avec une personne qui a la langue source comme langue maternelle ou bien directement avec l’auteurice), mais d’oublier qu’on écrit pour des comédiens, qu’on écrit écrit un texte destiné à être dit/interprété sur scène — l’erreur la plus grossière consisterait à écrire des phrases qui ne passeront pas l’épreuve du plateau. Les retours des comités de lecture, des comédiens / metteurses en scène sont essentiels.
J’ai échangé avec l’auteur, j’ai voulu adoucir l’humour, j’ai voulu intervenir, faire des propositions qui n’allaient pas dans le sens de ce qu’il voulait (par pusillanimité excessive de me part). L’auteur m’a donc ramené au texte et à son intention première. Et l’auteur doit avoir le dernier mot, sinon ce n’est plus de la traduction !
Entretien avec Véronique Bellegarde
Vous aimerez aussi

La Mousson d’été 2016
29 décembre 2015
L’Université d’été 2016
4 janvier 2016