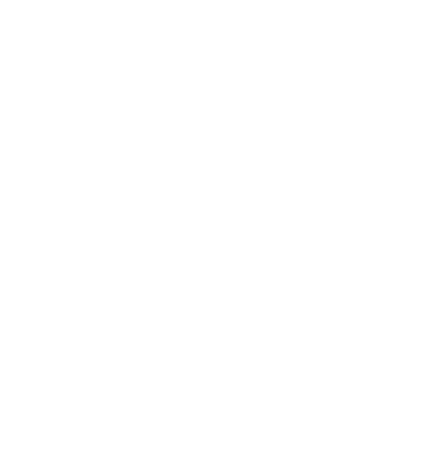« Les pluies battantes », de Marc-Antoine Cyr • Entretien avec l’auteur
Propos recueillis par Laetitia Guichenu
- Peux-tu présenter ton parcours d’auteur ?
Sorti de l’École nationale de théâtre du Canada, parcours Écriture dramatique, au tout début de ma vingtaine, j’ai mis quelques années à poursuivre mon apprentissage en voyageant de ci de là et en écrivant toujours beaucoup, partout, parfois à tâtons. Mes premiers essais théâtraux ont pu être vus dans quelques endroits du Québec. Au bout d’un temps, les résidences et les projets se sont additionnés en France, si bien qu’un jour, j’ai choisi de ne plus revenir à Montréal et de faire de Paris ma maison. J’y ai très vite rencontré mon éditeur, Quartett, qui m’est fidèle depuis lors, et des metteurs en scène avec qui j’ai pu maintenir de ravissants dialogues dans la durée. J’ai été un temps francophone, puis naturalisé. J’ai enfin eu l’impression d’arriver quelque part, tout en restant très nomade. La plupart de mes textes ont depuis été lus, joués, publiés, parfois traduits. Et si je continue d’écrire pour le théâtre (jeune et moins jeune public), j’écris aussi des scénarios pour la télé, en plus de participer à des manigances dramaturgiques à plusieurs mains. J’enseigne désormais la dramaturgie dans quelques écoles nationales, et je m’occupe d’un festival d’écritures contemporaines franco-québécois à Théâtre Ouvert depuis dix ans, le Jamais Lu Paris. Toutes ces activités participent selon moi de mon chemin d’écriture.
- Peux-tu expliciter ce que le théâtre apporte à ton entreprise d’écriture ?
J’ai ressenti le premier spectacle que j’ai vu comme une déflagration. Je devais avoir quinze ans, j’écrivais de très mauvais poèmes dans le secret de ma chambre, et il était très rare de voir du théâtre dans mon village de région. Je me rappelle m’être dit : je veux écrire ça, écrire pour provoquer ça, que des actrices et des acteurs parlent à ma place. Pour moi, les acteurs et les actrices agrandissent le langage, le temps, l’espace, le rêve, le possible. Écrire pour elles, pour eux, me galvanise. C’est comme allumer une mèche et pouvoir apprécier le brasier. Une grande part de mon apprentissage à l’École a été de les regarder travailler, puis de chercher le canal entre mon écriture et leur bouche, leur corps. Comment donner voix pour donner sens.
L’écriture théâtrale se tisse de contraintes très étroites, c’est un format prisonnier, une machinerie pesante, qui appelle davantage de « désécriture » que de vraies envolées. C’est en tout cas comme ça que je la perçois, et c’est exactement pour cette raison que je l’aime autant. Elle exige un effort d’artisan, une patience, un cent-fois-sur-le-métier qui me font pétiller le cerveau jour après jour, et qui me donnent envie de recommencer pour essayer de faire mieux, ou autrement.
- Peux-tu présenter ta pièce et ses enjeux sans trop la « divulgâcher » ?
Au départ, il y a deux femmes et un texte à déchiffrer. On s’imagine donc qu’il s’agit de deux actrices qui doivent s’emparer d’une fiction. Elles précisent d’ailleurs rigoureusement dès le départ quand c’est elles qui parlent, ou bien leur personnage. Puis, plus on avance dans l’histoire, plus on se rend compte que les rôles ne sont peut-être pas si étanches. Que l’actrice qui joue la mère a peut-être davantage en commun avec son rôle qu’on le croyait. Que l’actrice qui joue l’amie sait un peu plus de choses à propos du fils de Florence qu’elle le devrait.
La pièce s’amuse donc à donner la culbute à tous les rôles que l’on joue entre nous : parent, ami.e, fils ou fille, confidente. Elle fait de nos identités de petits quartz, elle les morcelle pour les faire luire séparément. La météo joue elle aussi un rôle, elle module les sensations des deux femmes jusqu’à les faire douter d’elles-mêmes. C’est un théâtre du dire, où il suffit qu’une chose soit nommée pour qu’elle devienne vraie.
- Dans quel contexte ce texte a-t-il été écrit ?
Le texte a jailli de plusieurs discussions que j’ai eues avec une amie actrice, qui me disait souffrir du peu de rôles attribués à des femmes d’âge mûr. Je me trouvais pour ma part dans une séquence de doute et de silence à propos de ma propre écriture. Je me demandais quoi raconter, sans trouver. J’avais peut-être un peu l’impression d’avoir tari la source, ou d’avoir déjà bégayé certaines histoires ou certains thèmes. J’ai toujours travaillé sur l’intime, alors à un moment on se fatigue de soi-même, non? C’était comme une jachère dont je cherchais l’issue. La flammèche s’est rallumée quand je me suis permis de travailler d’abord le comment raconter, en laissant les thématiques surgir d’elles-mêmes, sans les forcer. Du ludisme avec la langue, j’ai pu basculer dans une certaine vision du monde ou de l’époque qui a cimenté ma dramaturgie. Des sujets que je n’osais pas aborder avant que la fiction me les révèle. Parler du legs, de la perte, de sa propre disparition. On peut donc dire que ce texte a ravivé quelque chose en moi. De l’apaisement?
- Mes précédentes questions étant très attendues, y a-t-il une question que je n’ai pas posée à laquelle tu souhaiterais tout de même répondre ?
J’aurais aimé mettre bout à bout quelques noms d’autrices et d’auteurs de la génération nouvelle que je trouve incroyables, qui me bousculent et me bouleversent, et à qui je souhaite de l’or : Alexis Mullard, Inès Tahar, Esteban Okbi, Iris Laurent, Clément Piednoel Duval, Hicham Boutahar, Camille Giguère-Côté, Shiho Kasahara, Samantha Pardon, Azilys Tanneau, Nicolas Girard Michelotti, Ilonah Fagotin, Grégoire Vauquois, Sarah Hassenforder, Jean Serge Sallh, Lydie Tamisier, Kathleen Laurin McCarthy, Sylvain Septours… j’en oublie, pardon
Dans l'atelier de Nathalie Fillion
Vous aimerez aussi

Vidéo de présentation Mousson d’été
4 janvier 2016
L’Université d’été 2016
4 janvier 2016