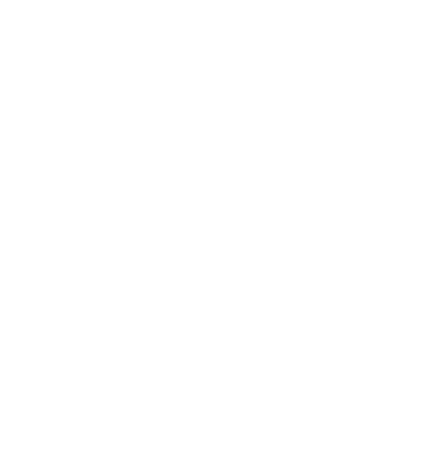« Nocturne » de Marius von Mayenburg • Entretien avec Robin Ormond
« Jusqu’où peut-on rire de ce qui nous hante ? »

Entretien pour Temporairement Contemporain
1. Impressions de lecture
La pièce mêle un quotidien banal à une charge mémorielle explosive. Comment s’inscrit ce texte dans le parcours d’écriture de Marius Von Mayenburg, et comment peut-on situer cet auteur au sein des écritures dramaturgiques allemandes ? Comment d’autre part avez-vous rencontré ce texte, et qu’est-ce qui, dans son atmosphère, dans ses tensions, a fait écho à votre désir de le porter à la scène — ou, ici, à la voix ?
Ce qui m’a frappé dès la première lecture, c’est la façon dont Nocturne articule un quotidien trivial, une fratrie qui vide la maison familiale, situation dramatique par excellence, avec comme vous le dites, une déflagration mémorielle qui arrive presque sans prévenir. Comme souvent chez Marius von Mayenburg, la comédie acide devient un terrain d’exploration des angles morts de la nature humaine, ici aux prises avec l’Histoire et son héritage. Dans le paysage dramaturgique allemand, il occupe une place singulière : héritier de la tradition postdramatique, mais toujours à part, car soucieux de construire des situations précises, dialoguées avec extrême précision, en alliant agilement ironie et grande crudité. Ici, il s’inscrit dans une lignée où l’on pourrait croiser Falk Richter, Roland Schimmelpfennig ou Sibylle Berg, voire Elfriede Jelinek : une écriture qui prend à bras-le-corps la mémoire allemande, le sentiment de culpabilité qui la sous-tend, en la frottant à l’intime et au grotesque.
J’ai découvert ce texte grâce à Laurent Muhleisen, mon ange-gardien de la dramaturgie, qui me l’avait donné à lire alors qu’il en finissait la traduction. Ce qui m’a décidé à le porter à la scène, ou plutôt à la voix, c’est évidemment l’honneur que m’a fait Véronique Bellegarde de me le proposer, et la joie immense de pouvoir enfin travailler dans ma région natale sur une écriture qui me fascine depuis plus de dix ans maintenant, et en particulier sur la tension constante qui articule le texte dans son ensemble, son humour qui écorche, nous met dans l’embarras et laisse affleurer une nappe souterraine de douleurs intemporelles.
2. Quels rires ?
Le rire dans Nocturne est acide, dérangeant, jubilatoire et par moment assez vertigineux dans l’audace que l’auteur se permet. Entre le grotesque et ce vertige, le rire pourrait même tout autant figurer une forme de résistance, que de fuite : en tous cas un révélateur d’angoisse collective. Comment vous situez-vous face à cette ironie grinçante, et comment pensez-vous la faire entendre au public ?
Le rire dans Nocturne est un rire de « déraillement » : il nous surprend au moment même où l’on se demande si l’on “a le droit” de rire. Mayenburg pousse ses personnages jusqu’au point où le grotesque et le vertige se confondent ; le public, pris au piège, rira, je l’espère, pour évacuer la gêne ou la peur. « Pourquoi je ris? » J’espère que cette question surgira. Pour moi, ce rire n’est pas un simple effet comique : il est, comme vous le dites, un révélateur d’angoisse collective, un mécanisme de défense qui montre combien nous sommes, aujourd’hui particulièrement, empêtrés dans les héritages du XXe siècle. Dans la mise en voix, j’aimerais que ce rire soit entendu comme un rire à double fond : qu’on puisse goûter la drôlerie des répliques, tout en percevant dans la vitesse de celles-ci la fissure par laquelle passe l’inconfort.
3. Questions d’héritage
À travers une fratrie déchirée, c’est toute une mémoire encombrée qui ressurgit, entre refoulement, kitsch et marchandisation du passé. Au-delà, si la pièce travaille la question de la mémoire collective et familiale (ce qu’on hérite, ce qu’on transmet), elle peut aussi poser la question de l’Histoire comme métaphore de toute transmission, et l’Histoire de la Seconde guerre Mondiale comme paradigme de celle-ci. Comment percevez-vous cette mémoire piégée ? Et que dit-elle, selon vous, de notre rapport contemporain à l’Histoire ?
Le texte parle d’héritage au sens strict, son point de départ étant ce tableau trouvé dans un grenier, mais il ouvre sur une réflexion beaucoup plus vaste : comment une mémoire collective s’incruste dans les récits familiaux, comment elle se transmet malgré nous, comment elle se tord, se recompose, se nie ou se monnaye. Ici, la Seconde Guerre mondiale agit comme un prisme : elle est à la fois un cas particulier, lourd d’un passé allemand inassumable, et une métaphore de toute transmission encombrante. On y observe une mémoire qui revêt en effet les atours d’un champ de mines. On ne peut se débarrasser des traces qu’elle laisse, pas plus qu’on ne peut réellement se les réapproprier : elle revient toujours, lancinante, souvent au mauvais moment, et elle porte en elle un mélange de honte et de fantasme marchandable. À mes yeux, le texte montre combien notre rapport contemporain à l’Histoire oscille entre fascination morbide et besoin d’en finir, sans qu’on sache au fond jamais vraiment comment.
4. Ouvertures
Il s’agit d’une mise en voix, mais aussi d’un signal d’ouverture – puisqu’il se trouve que la pièce ouvrira l’édition 2025 de la Mousson : une porte sur un théâtre qui interroge l’intime et le politique dans un même geste. Qu’est-ce qu’inaugurer le festival avec ce texte permet de poser, de convoquer ou d’annoncer ?
Ouvrir la Mousson avec Nocturne est à mon sens un signe artistique extrêmement courageux. C’est entrer tout de suite dans un théâtre qui assume d’affronter les contradictions, non seulement en croisant l’intime et le politique, sans chercher à simplifier, mais en créant avant tout un espace où la mémoire et le présent se télescopent : la voix des comédiens que je me réjouis de rencontrer au cours de ce travail, porte ici un débat qui dépasse largement le cadre familial car il interroge nos réflexes collectifs. Pour un festival, commencer par ce texte, c’est inviter le public à écouter autrement, attentivement, à se laisser aller à se demander : que fait-on de ce dont on hérite, qu’on le veuille ou non ? Mais surtout, jusqu’où peut-on rire de ce qui nous hante ?
Entretien avec Véronique Bellegarde
Vous aimerez aussi

Vidéo de présentation Mousson d’été
4 janvier 2016
Un article sur l’UE réalisé par un ancien stagiaire
5 janvier 2016