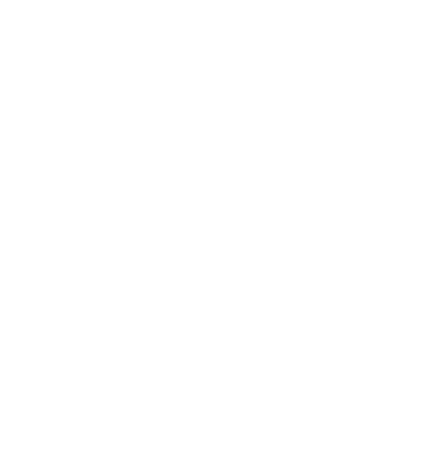« Dictées à Copenhague », Martha Isabel Márquez Quintero • Entretien avec Laurent Gallardo et François-Xavier Guerry, traducteurs
« Copenhague, c’est cet ailleurs et ce lieu de projections »
Comment situer cette œuvre dans le paysage théâtral colombien contemporain ? Quels échos ou dissonances y avez-vous perçus ?
LG : Force est d’abord de constater que le théâtre colombien est peu connu en Europe, surtout si on le compare à d’autres traditions latino-américaines jouissant d’une présence récurrente sur les scènes françaises, comme le théâtre argentin, uruguayen, chilien ou encore mexicain. C’est d’ailleurs cette méconnaissance qui a suscité l’intérêt du comité de lecture de la Mousson d’été. Après une tournée en Amérique latine, Nathalie Fillion est revenue avec une multitude de textes que nous avons pris plaisir à lire et à découvrir. Contrairement à l’idée reçue, il arrive souvent que la traduction anticipe la connaissance d’une œuvre ou d’un contexte théâtral donné, ce qui veut dire que l’on traduit pour connaître et non pas parce que l’on connaît. Ainsi donc, l’œuvre de Martha Isabel Márquez a constitué, pour nous aussi, un accès inédit au paysage théâtral colombien.
Les violences abordées dans la pièce (guerre, abus, injustice) traversent la mémoire collective colombienne – dans quelle mesure la pièce permet-elle de l’appréhender, de l’affronter, d’y faire face ?
FXG : Sans doute à travers une mémoire individuelle et fictive, celle d’un personnage qui n’existe pas mais dont on n’a aucun mal à percevoir qu’il incarne une sorte de victime emblématique de la société dans laquelle il vit et des violences qui la traversent.
LG : La pièce s’inspire pourtant d’un fait divers ayant marqué l’histoire de la Colombie, celui d’un serial killer qui, dans les années 90, a violé et assassiné plus de 200 mineurs. Le pays traverse alors un contexte politique extrêmement violent (guérilla des FARC, émergence de groupes paramilitaires d’extrême-droite, essor du trafic de drogue). Dans ce climat chaotique, la disparition de 200 mineurs passe dans un premier temps sous les radars… L’une des particularités de la pièce réside d’ailleurs dans l’acceptation tacite d’une violence sociale dont personne ne s’émeut, comme s’il s’agissait là d’une réalité quasiment banale. Quand on lit la pièce à travers notre prisme culturel, cette violence instituée acquiert soudain une dimension dystopique : y apparaît un monde désabusé où l’injustice et les abus de pouvoirs sont devenus la norme.
La géographie imaginaire (?) – ce village colombien nommé « Copenhague » – semble brouiller les repères. Selon vous, que dit ce choix toponymique ?
FXG : Ce toponyme crée un inévitable horizon d’attente chez le spectateur, qui s’attend à trouver ce qu’il ne trouve pas. L’image que l’on se fait de la capitale danoise, image probablement tout aussi stéréotypée que celle que le spectateur français se fait de la Colombie, est l’antithèse de ce village latino-américain dans lequel se déroule l’histoire. Le « vrai » Copenhague », comme le dit le texte, constitue un ailleurs inconnu mais désirable pour les personnages, un ailleurs plus policé et plus sûr, à l’évidence, par comparaison avec la réalité vécue, un lieu dans lequel le professeur rêve que ses élèves puissent vivre quand ils auront terminé leur scolarité. Paradoxalement, l’ancien élève, « exilé » au Danemark, et qui offre des billets d’avion à son professeur, exilé de « l’intérieur », quant à lui, affirme que « le plus bel endroit qui existe » est bel et bien l’autre Copenhague, le village colombien empreint d’une piété et d’une festivité populaires, et qui vit sous couvre-feu. Copenhague, c’est cet ailleurs et ce lieu de projections (comme le Danemark ou la Pologne, lieux de l’action d’Hamlet ou de La vie est un songe, respectivement).
LG : Je n’ai rien à ajouté à cette belle analyse de François-Xavier, si ce n’est qu’il y a aussi beaucoup d’humour dans ce jeu avec les toponymes, comme si, dès les premières répliques de la pièce, Martha Isabel Márquez nous disait : « vous pensiez que j’allais vous parler du Danemark ? Eh bien non ! Nous voici au fin fond de la campagne colombienne, en un lieu qui est l’image inversée ce que vous vous apprêtiez à voir ».
Pouvez-vous nous parler de votre collaboration ? Comment avez-vous articulé vos sensibilités de traducteurs autour d’un texte aussi dense et pluriel ?
LG : J’ai connu François-Xavier en lisant son très bel essai sur les continuations de La Célestine publié chez Classiques Garnier. Et j’ai tout de suite été fasciné par son style audacieux, sans commune mesure avec le verbiage aseptisé des essais universitaires. Aussi, lorsque François-Xavier m’a fait part de sa volonté de traduire, j’ai immédiatement eu envie de travailler avec lui. A travers cette collaboration, je souhaitais aussi me confronter à un certain impensé de ma pratique en traduisant sous le regard de François-Xavier, en assumant ses interrogations, ses doutes et aussi ses exigences. Cette collaboration n’aurait sûrement pas été possible avec les auteurs que je traduis habituellement. Mais, là, nous étions tous les deux dans une situation semblable : nous découvrions une autrice et il nous fallait inventer ensemble une façon de la traduire à travers un échange soutenu qui, me semble-t-il, a fini par enrichir notre lecture de la pièce.
FXG : Nous nous sommes répartis équitablement le texte à traduire, divisé, pour ce faire, en quatre parties (deux chacun), sur lesquelles nous avons travaillé de façon autonome, sans jamais cesser d’être en contact et de nous faire part de nos doutes, de nos interrogations et de nos « trouvailles » respectives. C’est ensuite que la collaboration a pris tout son sens : au gré de plusieurs séances de travail, cinq ou six au total, de plusieurs heures, nous avons repris l’ensemble du texte et mené un travail indispensable et systématique de mise en commun, d’harmonisation, d’uniformisation, bref de couture. Le texte se construit notamment autour de répétitions, de reprises de certains motifs et répliques, autant d’éléments sur lesquels il a fallu être particulièrement vigilants et accorder nos violons. Notre approche était complémentaire : Laurent, fort de son expérience, a eu la hauteur et le regard aguerri qu’il me manquait car, comme tout traducteur qui débute, je tendais à avoir une vision plus littérale de l’exercice et n’osais pas toujours assumer pleinement cette part de créativité propre à la traduction.
Le texte de Martha Isabel Márquez Quintero se distingue par une écriture circulaire, rythmée par les répétitions et les dictées : la langue semble ainsi s’enrouler sur elle-même, rejouant le fonctionnement d’un trauma obsédant, mais paraît traversée aussi d’ironie et lyrisme. Quelle musique intérieure avez-vous du texte en espagnol ? Et comment avez-vous tenté tous deux d’en conserver la justesse en français ?
FXG : Le texte de Martha Isabel Márquez donne, en effet, l’impression de vouloir mimétiser le ressassement obsessionnel du personnage, particulièrement visible à travers les dictées que celui-ci ânonne depuis des années, la répétition de certaines phrases, comme autant de mantras, ses pas qui le mènent irrémédiablement aux mêmes endroits (le parc, l’aéroport), son traumatisme et son enfermement dans la douleur, et l’insurmontable deuil du fils férocement assassiné. Cette psyché qui tend vers le psittacisme pathologique a donc son pendant formel, dans cette langue qui s’enroule sur elle-même, comme vous le dites, cette langue dont le personnage est prisonnier, lui qui répète inlassablement, par métier et par vocation, et dont il nous rend prisonniers. C’est cette musique-là qui saute aux yeux, ou aux oreilles, à la lecture du texte, a fortiori à voix haute, comme le Festival de la Mousson d’été en donne l’occasion, cette musique lancinante, qu’il a fallu rendre, ainsi que les jeux de redite. Sans y renoncer, il a parfois fallu alléger ce qui en espagnol posait moins de problèmes qu’en français : certaines répétitions, évidemment volontaires, et indispensables pour rendre compte de cet état d’esprit du personnage, ont dû être remaniées, sinon coupées, car elles donnaient l’impression de quelque chose de trop mécanique dans la langue d’arrivée, et grevaient le texte de lourdeurs dommageables. Il a fallu également être à l’écoute d’un texte qui, outre cette prose d’un personnage qui rabâche, cette prose qui infuse même hors de la salle de classe, se plaît à manier l’ellipse et les phrases nominales. C’est dans les didascalies que ce lyrisme dont vous parlez ou, du moins, une certaine recherche stylistique se font le plus sentir, un véritable travail d’autrice qui font de ces dernières autre chose que de simples instruments de régie.
LG : Et c’est dans le calibrage de ces effets stylistiques que l’échange entre traducteurs s’est avéré particulièrement intéressant. Je crois que nous avons évité le double écueil d’une traduction trop littérale où le ressassement aurait semblé sur-traduit et d’une recréation qui aurait limité à l’excès cette poétique de la répétition.
On perçoit que le personnage du dicteur est hanté par la voix de son fils, mais aussi par celle de la mémoire collective – elle paraît portée par une oralité singulière, faite de solennité et de trivialité. Toutes ces épaisseurs donnent un poids et une ouverture impressionnante. Comment avez-vous travaillé tous deux à restituer ces multiples strates de voix dans la langue française ?
FXG : Ce texte théâtral est traversé, effectivement, par plusieurs voix, voix qui se mêlent et s’entrecroisent : ainsi, les répliques du fils mort s’immiscent dans celles du père, et celles du père ressortissent autant à une sensibilité profondément individuelle et traumatique, marquée par une douleur aux accents on ne peut plus personnels, qu’à la répétition machinale de ce qui se dit au sein d’une salle de classe et qui semble échapper au contrôle d’un personnage modelé par son rôle et par ses dictées. Les répliques de l’adolescente pour laquelle le dicteur éprouve une coupable et irrésistible attirance sont autant d’éclats de voix, propres à l’enfance sur le point de s’éteindre, et pétries d’une ingénuité mâtinée de l’écho lointain des propos des parents et d’un éveil des sens qui peut mettre le spectateur mal à l’aise. Il faudrait ajouter l’allure verbale décalée du mendiant, le ton péremptoire et faussement neutre et distancié des forces de l’ordre et la litanie liturgique, qui n’est pas sans rappeler les dictées laïques… Ces voix ne se confondent pas, ou pas toujours, elles s’enchevêtrent volontiers, au gré des situations et des conversations.
LG : C’est cette polyphonie discrète, en ce qu’elle n’est nullement synonyme de cacophonie, qu’il s’agissait de rendre, qu’il fallait surtout ne pas aplatir, pas plus qu’il ne fallait l’intensifier ou la surjouer. Bien que ce ne soit pas dit sinon de façon tacite, cette voix du fils qui hante le père, jusqu’à la déraison et la maladie, est celle de l’ensemble des familles victimes de cet assassin en série, et, au-delà, de la société dans son entier, fracturée à l’évidence, et sous l’empire d’une violence exacerbée, violence dit légitime et illégitime. Autant de strates qu’il n’est pas aisé de tenir ensemble et d’associer, car cette voix ô combien personnelle qui révèle le tréfonds d’une âme et d’une force inconsciente, celle du père, est aussi celle, non pas impersonnelle, mais universelle et atemporelle, des hommes et d’un peuple.
Le personnage du dicteur est lui-même porteur d’une indéniable violence – tandis que l’assassin de son fils semble s’être amendé : le vertige moral de la pièce l’ouvre ainsi à une sorte d’abime politique quant aux issues que pourraient trouver les individus et la société face aux injustices… comment saisir cette trajectoire troublante ?
LG : La pièce s’évertue à éviter toute vision par trop manichéenne de ce que seraient la justice, la réparation, la rédemption et la vengeance, autant de concepts qui s’incarnent dans les deux personnages principaux que sont le dicteur et l’assassin en série. L’amendement de ce dernier et sa rencontre avec Dieu, alors qu’il se trouvait en prison, sont-ils acceptables, aux yeux du père de la victime, adolescent atrocement violé et tué, aux yeux de la société, aux yeux du public ? La peine d’incarcération qu’il a purgée peut sembler dérisoire compte tenu de l’immense gravité et l’irréversibilité des crimes commis et laisse à penser que l’on a affaire à une société dans laquelle règne une certaine impunité. Cette apparente conversion du personnage suffit-elle véritablement à le rédimer ? Le rend-elle légitime lorsqu’il affirme, dans la scène d’affrontement qui clôt l’œuvre, « Maintenant, tout ça est derrière moi. J’ai payé pour ce que j’ai fait » ? Et si le père crie à l’injustice (« Vous méritiez la peine de mort »), s’il refuse l’idée d’une « seconde chance », défendue par le violeur et assassin, qui, ironie du sort, va jusqu’à trouver la situation « injuste, absolument injuste », il n’empêche que lui non plus n’a pas l’attitude exemplaire que l’on attendrait. Mais qui a dit que les victimes devaient être exemplaires et que, portées par leur statut, leur vérité et leur souffrance avec lesquels la dramaturge nous pousse, légitimement, à compatir, elles ne devaient incarner que cela, cette douleur, ce statut et cette vérité ?
FXG : La violence, à des degrés divers, s’infiltre partout dans cette histoire, et elle émane de presque tous les personnages : de l’assassin, en premier lieu et de façon la plus éclatante, mais aussi de ce personnage de père, non monolithique, lui qui confond autorité et autoritarisme (comme l’État, pourrait-on penser, qui, en raison de la violence des cartels, et sous couvert du monopole de la violence légitime que l’on sait, impose un couvre-feu à l’ensemble de la population) dans la façon dont il éduque son fils, à coups de poing, de colère et de mots criés. Et, en dernière instance, de la société elle-même, qui, en raison de la guerre et de la menace non explicitée mais permanente de « bandits », se militarise et réduit ses soldats à compter et à retirer les morts pour les entreposer à la morgue. Le dicteur est l’une des nombreuses victimes de ce pays ravagé par la guerre et la crise — deux réalités explicitement mentionnées par lui, sans autre précision référentielle ou spécificatrice, deux réalités proprement universelles dès lors —, mais il n’en est pas moins bourreau lui-même, à sa façon, de son fils, on l’a dit, mais aussi de l’élève qui l’attend à la fin des cours et avec laquelle il entre dans un jeu on ne peut plus dangereux, ambigu et pervers, qui se termine par une agression et une tentative de viol. Si lui, à l’inverse de l’assassin, a su s’arrêter —trop tard quoi qu’il en soit et ayant de toute façon outrepassé les limites de la morale et du consentement—, il n’en demeure pas moins que tout ce qu’il a vécu, tout ce qu’il vit et ses répliques déchirantes sur l’impossible réhabilitation et l’expiation, qui le concernent au premier chef, sont relus et réinterprétés à l’aune de cette absence d’irréprochabilité du personnage.
Que vous a appris ce travail de traduction sur la langue française, mais aussi – peut-être – sur la langue espagnole, et sur vous-même ?
FXG : Ce travail de traduction m’a moins appris sur la langue espagnole ou la langue française, peut-être, à strictement parler, que sur les différences culturelles qu’elles charrient et qui donnent parfois du fil à retordre au traducteur. C’est ainsi que le système d’interlocution entre le père et le fils, puis le professeur et ses élèves, profondément lié aux réalités culturelles de chaque pays, a parfois soulevé quelques doutes (tutoiement, vouvoiement), et, plus particulièrement, et plus décisivement, tout ce qui relève du traitement que le dicteur réserve à son ancien élève, devenu adulte entre-temps, et son élève, adolescente elle. Il a fallu s’interroger sur les gestes de celle-ci envers son professeur, sur ce que pouvaient supposer, dans chacune des aires géographiques, celle de la langue source et celle de la langue cible, les accolades, les embrassades, voire les baisers, et déterminer, avec l’aide de l’autrice, s’il s’agissait de réalités culturelles structurelles ou s’il fallait mettre la chose sur le compte d’une situation fictionnelle singulière et peu représentative.
LG : Je partage l’avis de François-Xavier. C’est essentiellement sur ces questions culturelles qu’a porté notre réflexion. Nous avons tenté une approche qui ne soit ni trop sourcière (au risque de laisser dans le non-dit des éléments relevant de l’évidence pour le spectateur colombien) ni trop cibliste (afin de ne pas annuler la réflexion politique que charrie le texte quant à la réalité colombienne). Mais, comme toujours, on est confronté à des intraduisibles de nature linguistique et culturelle qui nous oblige à être inventifs. Le double sens du terme « dictador » dans la pièce (le « dictateur » mais aussi « celui qui fait des dictées ») nous a ainsi mis dans l’embarras… Ce que l’on apprend généralement de cette impossibilité de traduire, c’est qu’au théâtre le sens se construit aussi dans les béances du texte : ce que la traduction ne parvient pas à dire est souvent présenté, sous d’autres formes, dans la toile de fond dramaturgique de la pièce. Il faut donc faire confiance à celle-ci.
Quel écho pourrait trouver ce texte colombien, selon vous, sur les scènes francophones aujourd’hui ?
LG : Ce texte, ancré dans une réalité colombienne, aborde des questions universelles ayant trait à la banalité de la violence et ses conséquences sur les individus. Sur le plan politique, l’Amérique latine a souvent été un laboratoire politique où se dessine le devenir de nos sociétés occidentales. Il convient donc d’être à l’écoute de ce qui joue dans de l’autre côté de l’océan, qui plus est à une époque où les digues démocratiques sont en train de céder et où la violence et le rapport de force semblent de plus en plus légitimés par certains discours politiques.
FXG : La pièce montre notamment comment l’injustice appelle l’injustice et la violence entraîne la violence. D’une certaine manière, on se demande, à la lecture de la pièce, si la loi du talion (« œil pour œil, dent pour dent ») est un remède à la douleur. On peut en douter et c’est là une leçon qu’il nous faut entendre.
Comment situer cette œuvre dans le paysage théâtral colombien contemporain ? Quels échos ou dissonances y avez-vous perçus ?
LG : Force est d’abord de constater que le théâtre colombien est peu connu en Europe, surtout si on le compare à d’autres traditions latino-américaines jouissant d’une présence récurrente sur les scènes françaises, comme le théâtre argentin, uruguayen, chilien ou encore mexicain. C’est d’ailleurs cette méconnaissance qui a suscité l’intérêt du comité de lecture de la Mousson d’été. Après une tournée en Amérique latine, Nathalie Fillion est revenue avec une multitude de textes que nous avons pris plaisir à lire et à découvrir. Contrairement à l’idée reçue, il arrive souvent que la traduction anticipe la connaissance d’une œuvre ou d’un contexte théâtral donné, ce qui veut dire que l’on traduit pour connaître et non pas parce que l’on connaît. Ainsi donc, l’œuvre de Martha Isabel Márquez a constitué, pour nous aussi, un accès inédit au paysage théâtral colombien.
Les violences abordées dans la pièce (guerre, abus, injustice) traversent la mémoire collective colombienne – dans quelle mesure la pièce permet-elle de l’appréhender, de l’affronter, d’y faire face ?
FXG : Sans doute à travers une mémoire individuelle et fictive, celle d’un personnage qui n’existe pas mais dont on n’a aucun mal à percevoir qu’il incarne une sorte de victime emblématique de la société dans laquelle il vit et des violences qui la traversent.
LG : La pièce s’inspire pourtant d’un fait divers ayant marqué l’histoire de la Colombie, celui d’un serial killer qui, dans les années 90, a violé et assassiné plus de 200 mineurs. Le pays traverse alors un contexte politique extrêmement violent (guérilla des FARC, émergence de groupes paramilitaires d’extrême-droite, essor du trafic de drogue). Dans ce climat chaotique, la disparition de 200 mineurs passe dans un premier temps sous les radars… L’une des particularités de la pièce réside d’ailleurs dans l’acceptation tacite d’une violence sociale dont personne ne s’émeut, comme s’il s’agissait là d’une réalité quasiment banale. Quand on lit la pièce à travers notre prisme culturel, cette violence instituée acquiert soudain une dimension dystopique : y apparaît un monde désabusé où l’injustice et les abus de pouvoirs sont devenus la norme.
La géographie imaginaire (?) – ce village colombien nommé « Copenhague » – semble brouiller les repères. Selon vous, que dit ce choix toponymique ?
FXG : Ce toponyme crée un inévitable horizon d’attente chez le spectateur, qui s’attend à trouver ce qu’il ne trouve pas. L’image que l’on se fait de la capitale danoise, image probablement tout aussi stéréotypée que celle que le spectateur français se fait de la Colombie, est l’antithèse de ce village latino-américain dans lequel se déroule l’histoire. Le « vrai » Copenhague », comme le dit le texte, constitue un ailleurs inconnu mais désirable pour les personnages, un ailleurs plus policé et plus sûr, à l’évidence, par comparaison avec la réalité vécue, un lieu dans lequel le professeur rêve que ses élèves puissent vivre quand ils auront terminé leur scolarité. Paradoxalement, l’ancien élève, « exilé » au Danemark, et qui offre des billets d’avion à son professeur, exilé de « l’intérieur », quant à lui, affirme que « le plus bel endroit qui existe » est bel et bien l’autre Copenhague, le village colombien empreint d’une piété et d’une festivité populaires, et qui vit sous couvre-feu. Copenhague, c’est cet ailleurs et ce lieu de projections (comme le Danemark ou la Pologne, lieux de l’action d’Hamlet ou de La vie est un songe, respectivement).
LG : Je n’ai rien à ajouté à cette belle analyse de François-Xavier, si ce n’est qu’il y a aussi beaucoup d’humour dans ce jeu avec les toponymes, comme si, dès les premières répliques de la pièce, Martha Isabel Márquez nous disait : « vous pensiez que j’allais vous parler du Danemark ? Eh bien non ! Nous voici au fin fond de la campagne colombienne, en un lieu qui est l’image inversée ce que vous vous apprêtiez à voir ».
Pouvez-vous nous parler de votre collaboration ? Comment avez-vous articulé vos sensibilités de traducteurs autour d’un texte aussi dense et pluriel ?
LG : J’ai connu François-Xavier en lisant son très bel essai sur les continuations de La Célestine publié chez Classiques Garnier. Et j’ai tout de suite été fasciné par son style audacieux, sans commune mesure avec le verbiage aseptisé des essais universitaires. Aussi, lorsque François-Xavier m’a fait part de sa volonté de traduire, j’ai immédiatement eu envie de travailler avec lui. A travers cette collaboration, je souhaitais aussi me confronter à un certain impensé de ma pratique en traduisant sous le regard de François-Xavier, en assumant ses interrogations, ses doutes et aussi ses exigences. Cette collaboration n’aurait sûrement pas été possible avec les auteurs que je traduis habituellement. Mais, là, nous étions tous les deux dans une situation semblable : nous découvrions une autrice et il nous fallait inventer ensemble une façon de la traduire à travers un échange soutenu qui, me semble-t-il, a fini par enrichir notre lecture de la pièce.
FXG : Nous nous sommes répartis équitablement le texte à traduire, divisé, pour ce faire, en quatre parties (deux chacun), sur lesquelles nous avons travaillé de façon autonome, sans jamais cesser d’être en contact et de nous faire part de nos doutes, de nos interrogations et de nos « trouvailles » respectives. C’est ensuite que la collaboration a pris tout son sens : au gré de plusieurs séances de travail, cinq ou six au total, de plusieurs heures, nous avons repris l’ensemble du texte et mené un travail indispensable et systématique de mise en commun, d’harmonisation, d’uniformisation, bref de couture. Le texte se construit notamment autour de répétitions, de reprises de certains motifs et répliques, autant d’éléments sur lesquels il a fallu être particulièrement vigilants et accorder nos violons. Notre approche était complémentaire : Laurent, fort de son expérience, a eu la hauteur et le regard aguerri qu’il me manquait car, comme tout traducteur qui débute, je tendais à avoir une vision plus littérale de l’exercice et n’osais pas toujours assumer pleinement cette part de créativité propre à la traduction.
Le texte de Martha Isabel Márquez Quintero se distingue par une écriture circulaire, rythmée par les répétitions et les dictées : la langue semble ainsi s’enrouler sur elle-même, rejouant le fonctionnement d’un trauma obsédant, mais paraît traversée aussi d’ironie et lyrisme. Quelle musique intérieure avez-vous du texte en espagnol ? Et comment avez-vous tenté tous deux d’en conserver la justesse en français ?
FXG : Le texte de Martha Isabel Márquez donne, en effet, l’impression de vouloir mimétiser le ressassement obsessionnel du personnage, particulièrement visible à travers les dictées que celui-ci ânonne depuis des années, la répétition de certaines phrases, comme autant de mantras, ses pas qui le mènent irrémédiablement aux mêmes endroits (le parc, l’aéroport), son traumatisme et son enfermement dans la douleur, et l’insurmontable deuil du fils férocement assassiné. Cette psyché qui tend vers le psittacisme pathologique a donc son pendant formel, dans cette langue qui s’enroule sur elle-même, comme vous le dites, cette langue dont le personnage est prisonnier, lui qui répète inlassablement, par métier et par vocation, et dont il nous rend prisonniers. C’est cette musique-là qui saute aux yeux, ou aux oreilles, à la lecture du texte, a fortiori à voix haute, comme le Festival de la Mousson d’été en donne l’occasion, cette musique lancinante, qu’il a fallu rendre, ainsi que les jeux de redite. Sans y renoncer, il a parfois fallu alléger ce qui en espagnol posait moins de problèmes qu’en français : certaines répétitions, évidemment volontaires, et indispensables pour rendre compte de cet état d’esprit du personnage, ont dû être remaniées, sinon coupées, car elles donnaient l’impression de quelque chose de trop mécanique dans la langue d’arrivée, et grevaient le texte de lourdeurs dommageables. Il a fallu également être à l’écoute d’un texte qui, outre cette prose d’un personnage qui rabâche, cette prose qui infuse même hors de la salle de classe, se plaît à manier l’ellipse et les phrases nominales. C’est dans les didascalies que ce lyrisme dont vous parlez ou, du moins, une certaine recherche stylistique se font le plus sentir, un véritable travail d’autrice qui fait de ces dernières autre chose que de simples instruments de régie.
LG : Et c’est dans le calibrage de ces effets stylistiques que l’échange entre traducteurs s’est avéré particulièrement intéressant. Je crois que nous avons évité le double écueil d’une traduction trop littérale où le ressassement aurait semblé sur-traduit et d’une recréation qui aurait limité à l’excès cette poétique de la répétition.
On perçoit que le personnage du dicteur est hanté par la voix de son fils, mais aussi par celle de la mémoire collective – elle paraît portée par une oralité singulière, faite de solennité et de trivialité. Toutes ces épaisseurs donnent un poids et une ouverture impressionnante. Comment avez-vous travaillé tous deux à restituer ces multiples strates de voix dans la langue française ?
FXG : Ce texte théâtral est traversé, effectivement, par plusieurs voix, voix qui se mêlent et s’entrecroisent : ainsi, les répliques du fils mort s’immiscent dans celles du père, et celles du père ressortissent autant à une sensibilité profondément individuelle et traumatique, marquée par une douleur aux accents on ne peut plus personnelles, qu’à la répétition machinale de ce qui se dit au sein d’une salle de classe et qui semble échapper au contrôle d’un personnage modelé par son rôle et par ses dictées. Les répliques de l’adolescente pour laquelle le dicteur éprouve une coupable et irrésistible attirance sont autant d’éclats de voix, propres à l’enfance sur le point de s’éteindre, et pétries d’une ingénuité mâtinée de l’écho lointain des propos des parents et d’un éveil des sens qui peut mettre le spectateur mal à l’aise. Il faudrait ajouter l’allure verbale décalée du mendiant, le ton péremptoire et faussement neutre et distancié des forces de l’ordre et la litanie liturgique, qui n’est pas sans rappeler les dictées laïques… Ces voix ne se confondent pas, ou pas toujours, elles s’enchevêtrent volontiers, au gré des situations et des conversations.
LG : C’est cette polyphonie discrète, en ce qu’elle n’est nullement synonyme de cacophonie, qu’il s’agissait de rendre, qu’il fallait surtout ne pas aplatir, pas plus qu’il ne fallait l’intensifier ou la surjouer. Bien que ce ne soit pas dit sinon de façon tacite, cette voix du fils qui hante le père, jusqu’à la déraison et la maladie, est celle de l’ensemble des familles victimes de cet assassin en série, et, au-delà, de la société dans son entier, fracturée à l’évidence, et sous l’empire d’une violence exacerbée, violence dit légitime et illégitime. Autant de strates qu’il n’est pas aisé de tenir ensemble et d’associer, car cette voix ô combien personnelle qui révèle le tréfonds d’une âme et d’une force inconsciente, celle du père, est aussi celle, non pas impersonnelle, mais universelle et atemporelle, des hommes et d’un peuple.
Le personnage du dicteur est lui-même porteur d’une indéniable violence – tandis que l’assassin de son fils semble s’être amendé : le vertige moral de la pièce l’ouvre ainsi à une sorte d’abime politique quant aux issues que pourraient trouver les individus et la société face aux injustices… comment saisir cette trajectoire troublante ?
LG : La pièce s’évertue à éviter toute vision par trop manichéenne de ce que seraient la justice, la réparation, la rédemption et la vengeance, autant de concepts qui s’incarnent dans les deux personnages principaux que sont le dicteur et l’assassin en série. L’amendement de ce dernier et sa rencontre avec Dieu, alors qu’il se trouvait en prison, sont-ils acceptables, aux yeux du père de la victime, adolescent atrocement violé et tué, aux yeux de la société, aux yeux du public ? La peine d’incarcération qu’il a purgée peut sembler dérisoire compte tenu de l’immense gravité et l’irréversibilité des crimes commis et laisse à penser que l’on a affaire à une société dans laquelle règne une certaine impunité. Cette apparente conversion du personnage suffit-elle véritablement à le rédimer ? Le rend-elle légitime lorsqu’il affirme, dans la scène d’affrontement qui clôt l’œuvre, « Maintenant, tout ça est derrière moi. J’ai payé pour ce que j’ai fait » ? Et si le père crie à l’injustice (« Vous méritiez la peine de mort »), s’il refuse l’idée d’une « seconde chance », défendue par le violeur et assassin, qui, ironie du sort, va jusqu’à trouver la situation « injuste, absolument injuste », il n’empêche que lui non plus n’a pas l’attitude exemplaire que l’on attendrait. Mais qui a dit que les victimes devaient être exemplaires et que, portées par leur statut, leur vérité et leur souffrance avec lesquels la dramaturge nous pousse, légitimement, à compatir, elles ne devaient incarner que cela, cette douleur, ce statut et cette vérité ?
FXG : La violence, à des degrés divers s’infiltre partout dans cette histoire, et elle émane de presque tous les personnages : de l’assassin, en premier lieu et de façon la plus éclatante, mais aussi de ce personnage de père, non monolithique, lui qui confond autorité et autoritarisme (comme l’État, pourrait-on penser, qui, en raison de la violence des cartels, et sous couvert du monopole de la violence légitime que l’on sait, impose un couvre-feu à l’ensemble de la population) dans la façon dont il éduque son fils, à coups de poing, de colère et de mots criés. Et, en dernière instance, de la société elle-même, qui, en raison de la guerre et de la menace non explicitée mais permanente de « bandits », se militarise et réduit ses soldats à compter et à retirer les morts pour les entreposer à la morgue. Le dicteur est l’une des nombreuses victimes de ce pays ravagé par la guerre et la crise — deux réalités explicitement mentionnées par lui, sans autre précision référentielle ou spécificatrice, deux réalités proprement universelles dès lors —, mais il n’en est pas moins bourreau lui-même, à sa façon, de son fils, on l’a dit, mais aussi de l’élève qui l’attend à la fin des cours et avec laquelle il entre dans un jeu on ne peut plus dangereux, ambigu et pervers, qui se termine par une agression et une tentative de viol. Si lui, à l’inverse de l’assassin, a su s’arrêter —trop tard quoi qu’il en soit et ayant de toute façon outrepassé les limites de la morale et du consentement—, il n’en demeure pas moins que tout ce qu’il a vécu, tout ce qu’il vit et ses répliques déchirantes sur l’impossible réhabilitation et l’expiation, qui le concernent au premier chef, sont relus et réinterprétés à l’aune de cette absence d’irréprochabilité du personnage.
Que vous a appris ce travail de traduction sur la langue française, mais aussi – peut-être – sur la langue espagnole, et sur vous-même ?
FXG : Ce travail de traduction m’a moins appris sur la langue espagnole ou la langue française, peut-être, à strictement parler, que sur les différences culturelles qu’elles charrient et qui donnent parfois du fil à retordre au traducteur. C’est ainsi que le système d’interlocution entre le père et le fils, puis le professeur et ses élèves, profondément lié aux réalités culturelles de chaque pays, a parfois soulevé quelques doutes (tutoiement, vouvoiement), et, plus particulièrement, et plus décisivement, tout ce qui relève du traitement que le dicteur réserve à son ancien élève, devenu adulte entre-temps, et son élève, adolescente elle. Il a fallu s’interroger sur les gestes de celle-ci envers son professeur, sur ce que pouvaient supposer, dans chacune des aires géographiques, celle de la langue source et celle de la langue cible, les accolades, les embrassades, voire les baisers, et déterminer, avec l’aide de l’autrice, s’il s’agissait de réalités culturelles structurelles ou s’il fallait mettre la chose sur le compte d’une situation fictionnelle singulière et peu représentative.
LG : Je partage l’avis de François-Xavier. C’est essentiellement sur ces questions culturelles qu’a porté notre réflexion. Nous avons tenté une approche qui ne soit ni trop sourcière (au risque de laisser dans le non-dit des éléments relevant de l’évidence pour le spectateur colombien) ni trop cibliste (afin de ne pas annuler la réflexion politique que charrie le texte quant à la réalité colombienne). Mais, comme toujours, on est confronté à des intraduisibles de nature linguistique et culturelle qui nous oblige à être inventifs. Le double sens du terme « dictador » dans la pièce (le « dictateur » mais aussi « celui qui fait des dictées ») nous a ainsi mis dans l’embarras… Ce que l’on apprend généralement de cette impossibilité de traduire, c’est qu’au théâtre le sens se construit aussi dans les béances du texte : ce que la traduction ne parvient pas à dire est souvent présenté, sous d’autres formes, dans la toile de fond dramaturgique de la pièce. Il faut donc faire confiance à celle-ci.
Quel écho pourrait trouver ce texte colombien, selon vous, sur les scènes francophones aujourd’hui ?
LG : Ce texte, ancré dans une réalité colombienne, aborde des questions universelles ayant trait à la banalité de la violence et ses conséquences sur les individus. Sur le plan politique, l’Amérique latine a souvent été un laboratoire politique où se dessine le devenir de nos sociétés occidentales. Il convient donc d’être à l’écoute de ce qui joue dans de l’autre côté de l’océan, qui plus est à une époque où les digues démocratiques sont en train de céder et où la violence et le rapport de force semblent de plus en plus légitimés par certains discours politiques.
FXG : La pièce montre notamment comment l’injustice appelle l’injustice et la violence entraîne la violence. D’une certaine manière, on se demande, à la lecture de la pièce, si la loi du talion (« œil pour œil, dent pour dent) est un remède à la douleur. On peut en douter et c’est là une leçon qu’il nous faut entendre.
Comment situer cette œuvre dans le paysage théâtral colombien contemporain ? Quels échos ou dissonances y avez-vous perçus ?
LG : Force est d’abord de constater que le théâtre colombien est peu connu en Europe, surtout si on le compare à d’autres traditions latino-américaines jouissant d’une présence récurrente sur les scènes françaises, comme le théâtre argentin, uruguayen, chilien ou encore mexicain. C’est d’ailleurs cette méconnaissance qui a suscité l’intérêt du comité de lecture de la Mousson d’été. Après une tournée en Amérique latine, Nathalie Fillion est revenue avec une multitude de textes que nous avons pris plaisir à lire et à découvrir. Contrairement à l’idée reçue, il arrive souvent que la traduction anticipe la connaissance d’une œuvre ou d’un contexte théâtral donné, ce qui veut dire que l’on traduit pour connaître et non pas parce que l’on connaît. Ainsi donc, l’œuvre de Martha Isabel Márquez a constitué, pour nous aussi, un accès inédit au paysage théâtral colombien.
Les violences abordées dans la pièce (guerre, abus, injustice) traversent la mémoire collective colombienne – dans quelle mesure la pièce permet-elle de l’appréhender, de l’affronter, d’y faire face ?
FXG : Sans doute à travers une mémoire individuelle et fictive, celle d’un personnage qui n’existe pas mais dont on n’a aucun mal à percevoir qu’il incarne une sorte de victime emblématique de la société dans laquelle il vit et des violences qui la traversent.
LG : La pièce s’inspire pourtant d’un fait divers ayant marqué l’histoire de la Colombie, celui d’un serial killer qui, dans les années 90, a violé et assassiné plus de 200 mineurs. Le pays traverse alors un contexte politique extrêmement violent (guérilla des FARC, émergence de groupes paramilitaires d’extrême-droite, essor du trafic de drogue). Dans ce climat chaotique, la disparition de 200 mineurs passe dans un premier temps sous les radars… L’une des particularités de la pièce réside d’ailleurs dans l’acceptation tacite d’une violence sociale dont personne ne s’émeut, comme s’il s’agissait là d’une réalité quasiment banale. Quand on lit la pièce à travers notre prisme culturel, cette violence instituée acquiert soudain une dimension dystopique : y apparaît un monde désabusé où l’injustice et les abus de pouvoirs sont devenus la norme.
La géographie imaginaire (?) – ce village colombien nommé « Copenhague » – semble brouiller les repères. Selon vous, que dit ce choix toponymique ?
FXG : Ce toponyme crée un inévitable horizon d’attente chez le spectateur, qui s’attend à trouver ce qu’il ne trouve pas. L’image que l’on se fait de la capitale danoise, image probablement tout aussi stéréotypée que celle que le spectateur français se fait de la Colombie, est l’antithèse de ce village latino-américain dans lequel se déroule l’histoire. Le « vrai » Copenhague », comme le dit le texte, constitue un ailleurs inconnu mais désirable pour les personnages, un ailleurs plus policé et plus sûr, à l’évidence, par comparaison avec la réalité vécue, un lieu dans lequel le professeur rêve que ses élèves puissent vivre quand ils auront terminé leur scolarité. Paradoxalement, l’ancien élève, « exilé » au Danemark, et qui offre des billets d’avion à son professeur, exilé de « l’intérieur », quant à lui, affirme que « le plus bel endroit qui existe » est bel et bien l’autre Copenhague, le village colombien empreint d’une piété et d’une festivité populaires, et qui vit sous couvre-feu. Copenhague, c’est cet ailleurs et ce lieu de projections (comme le Danemark ou la Pologne, lieux de l’action d’Hamlet ou de La vie est un songe, respectivement).
LG : Je n’ai rien à ajouté à cette belle analyse de François-Xavier, si ce n’est qu’il y a aussi beaucoup d’humour dans ce jeu avec les toponymes, comme si, dès les premières répliques de la pièce, Martha Isabel Márquez nous disait : « vous pensiez que j’allais vous parler du Danemark ? Eh bien non ! Nous voici au fin fond de la campagne colombienne, en un lieu qui est l’image inversée ce que vous vous apprêtiez à voir ».
Pouvez-vous nous parler de votre collaboration ? Comment avez-vous articulé vos sensibilités de traducteurs autour d’un texte aussi dense et pluriel ?
LG : J’ai connu François-Xavier en lisant son très bel essai sur les continuations de La Célestine publié chez Classiques Garnier. Et j’ai tout de suite été fasciné par son style audacieux, sans commune mesure avec le verbiage aseptisé des essais universitaires. Aussi, lorsque François-Xavier m’a fait part de sa volonté de traduire, j’ai immédiatement eu envie de travailler avec lui. A travers cette collaboration, je souhaitais aussi me confronter à un certain impensé de ma pratique en traduisant sous le regard de François-Xavier, en assumant ses interrogations, ses doutes et aussi ses exigences. Cette collaboration n’aurait sûrement pas été possible avec les auteurs que je traduis habituellement. Mais, là, nous étions tous les deux dans une situation semblable : nous découvrions une autrice et il nous fallait inventer ensemble une façon de la traduire à travers un échange soutenu qui, me semble-t-il, a fini par enrichir notre lecture de la pièce.
FXG : Nous nous sommes répartis équitablement le texte à traduire, divisé, pour ce faire, en quatre parties (deux chacun), sur lesquelles nous avons travaillé de façon autonome, sans jamais cesser d’être en contact et de nous faire part de nos doutes, de nos interrogations et de nos « trouvailles » respectives. C’est ensuite que la collaboration a pris tout son sens : au gré de plusieurs séances de travail, cinq ou six au total, de plusieurs heures, nous avons repris l’ensemble du texte et mené un travail indispensable et systématique de mise en commun, d’harmonisation, d’uniformisation, bref de couture. Le texte se construit notamment autour de répétitions, de reprises de certains motifs et répliques, autant d’éléments sur lesquels il a fallu être particulièrement vigilants et accorder nos violons. Notre approche était complémentaire : Laurent, fort de son expérience, a eu la hauteur et le regard aguerri qu’il me manquait car, comme tout traducteur qui débute, je tendais à avoir une vision plus littérale de l’exercice et n’osais pas toujours assumer pleinement cette part de créativité propre à la traduction.
Le texte de Martha Isabel Márquez Quintero se distingue par une écriture circulaire, rythmée par les répétitions et les dictées : la langue semble ainsi s’enrouler sur elle-même, rejouant le fonctionnement d’un trauma obsédant, mais paraît traversée aussi d’ironie et lyrisme. Quelle musique intérieure avez-vous du texte en espagnol ? Et comment avez-vous tenté tous deux d’en conserver la justesse en français ?
FXG : Le texte de Martha Isabel Márquez donne, en effet, l’impression de vouloir mimétiser le ressassement obsessionnel du personnage, particulièrement visible à travers les dictées que celui-ci ânonne depuis des années, la répétition de certaines phrases, comme autant de mantras, ses pas qui le mènent irrémédiablement aux mêmes endroits (le parc, l’aéroport), son traumatisme et son enfermement dans la douleur, et l’insurmontable deuil du fils férocement assassiné. Cette psyché qui tend vers le psittacisme pathologique a donc son pendant formel, dans cette langue qui s’enroule sur elle-même, comme vous le dites, cette langue dont le personnage est prisonnier, lui qui répète inlassablement, par métier et par vocation, et dont il nous rend prisonniers. C’est cette musique-là qui saute aux yeux, ou aux oreilles, à la lecture du texte, a fortiori à voix haute, comme le Festival de la Mousson d’été en donne l’occasion, cette musique lancinante, qu’il a fallu rendre, ainsi que les jeux de redite. Sans y renoncer, il a parfois fallu alléger ce qui en espagnol posait moins de problèmes qu’en français : certaines répétitions, évidemment volontaires, et indispensables pour rendre compte de cet état d’esprit du personnage, ont dû être remaniées, sinon coupées, car elles donnaient l’impression de quelque chose de trop mécanique dans la langue d’arrivée, et grevaient le texte de lourdeurs dommageables. Il a fallu également être à l’écoute d’un texte qui, outre cette prose d’un personnage qui rabâche, cette prose qui infuse même hors de la salle de classe, se plaît à manier l’ellipse et les phrases nominales. C’est dans les didascalies que ce lyrisme dont vous parlez ou, du moins, une certaine recherche stylistique se font le plus sentir, un véritable travail d’autrice qui font de ces dernières autre chose que de simples instruments de régie.
LG : Et c’est dans le calibrage de ces effets stylistiques que l’échange entre traducteurs s’est avéré particulièrement intéressant. Je crois que nous avons évité le double écueil d’une traduction trop littérale où le ressassement aurait semblé sur-traduit et d’une recréation qui aurait limité à l’excès cette poétique de la répétition.
On perçoit que le personnage du dicteur est hanté par la voix de son fils, mais aussi par celle de la mémoire collective – elle paraît portée par une oralité singulière, faite de solennité et de trivialité. Toutes ces épaisseurs donnent un poids et une ouverture impressionnante. Comment avez-vous travaillé tous deux à restituer ces multiples strates de voix dans la langue française ?
FXG : Ce texte théâtral est traversé, effectivement, par plusieurs voix, voix qui se mêlent et s’entrecroisent : ainsi, les répliques du fils mort s’immiscent dans celles du père, et celles du père ressortissent autant à une sensibilité profondément individuelle et traumatique, marquée par une douleur aux accents on ne peut plus personnelles, qu’à la répétition machinale de ce qui se dit au sein d’une salle de classe et qui semble échapper au contrôle d’un personnage modelé par son rôle et par ses dictées. Les répliques de l’adolescente pour laquelle le dicteur éprouve une coupable et irrésistible attirance sont autant d’éclats de voix, propres à l’enfance sur le point de s’éteindre, et pétries d’une ingénuité mâtinée de l’écho lointain des propos des parents et d’un éveil des sens qui peut mettre le spectateur mal à l’aise. Il faudrait ajouter l’allure verbale décalée du mendiant, le ton péremptoire et faussement neutre et distancié des forces de l’ordre et la litanie liturgique, qui n’est pas sans rappeler les dictées laïques… Ces voix ne se confondent pas, ou pas toujours, elles s’enchevêtrent volontiers, au gré des situations et des conversations.
LG : C’est cette polyphonie discrète, en ce qu’elle n’est nullement synonyme de cacophonie, qu’il s’agissait de rendre, qu’il fallait surtout ne pas aplatir, pas plus qu’il ne fallait l’intensifier ou la surjouer. Bien que ce ne soit pas dit sinon de façon tacite, cette voix du fils qui hante le père, jusqu’à la déraison et la maladie, est celle de l’ensemble des familles victimes de cet assassin en série, et, au-delà, de la société dans son entier, fracturée à l’évidence, et sous l’empire d’une violence exacerbée, violence dit légitime et illégitime. Autant de strates qu’il n’est pas aisé de tenir ensemble et d’associer, car cette voix ô combien personnelle qui révèle le tréfonds d’une âme et d’une force inconsciente, celle du père, est aussi celle, non pas impersonnelle, mais universelle et atemporelle, des hommes et d’un peuple.
Le personnage du dicteur est lui-même porteur d’une indéniable violence – tandis que l’assassin de son fils semble s’être amendé : le vertige moral de la pièce l’ouvre ainsi à une sorte d’abime politique quant aux issues que pourraient trouver les individus et la société face aux injustices… comment saisir cette trajectoire troublante ?
LG : La pièce s’évertue à éviter toute vision par trop manichéenne de ce que seraient la justice, la réparation, la rédemption et la vengeance, autant de concepts qui s’incarnent dans les deux personnages principaux que sont le dicteur et l’assassin en série. L’amendement de ce dernier et sa rencontre avec Dieu, alors qu’il se trouvait en prison, sont-ils acceptables, aux yeux du père de la victime, adolescent atrocement violé et tué, aux yeux de la société, aux yeux du public ? La peine d’incarcération qu’il a purgée peut sembler dérisoire compte tenu de l’immense gravité et l’irréversibilité des crimes commis et laisse à penser que l’on a affaire à une société dans laquelle règne une certaine impunité. Cette apparente conversion du personnage suffit-elle véritablement à le rédimer ? Le rend-elle légitime lorsqu’il affirme, dans la scène d’affrontement qui clôt l’œuvre, « Maintenant, tout ça est derrière moi. J’ai payé pour ce que j’ai fait » ? Et si le père crie à l’injustice (« Vous méritiez la peine de mort »), s’il refuse l’idée d’une « seconde chance », défendue par le violeur et assassin, qui, ironie du sort, va jusqu’à trouver la situation « injuste, absolument injuste », il n’empêche que lui non plus n’a pas l’attitude exemplaire que l’on attendrait. Mais qui a dit que les victimes devaient être exemplaires et que, portées par leur statut, leur vérité et leur souffrance avec lesquels la dramaturge nous pousse, légitimement, à compatir, elles ne devaient incarner que cela, cette douleur, ce statut et cette vérité ?
FXG : La violence, à des degrés divers s’infiltre partout dans cette histoire, et elle émane de presque tous les personnages : de l’assassin, en premier lieu et de façon la plus éclatante, mais aussi de ce personnage de père, non monolithique, lui qui confond autorité et autoritarisme (comme l’État, pourrait-on penser, qui, en raison de la violence des cartels, et sous couvert du monopole de la violence légitime que l’on sait, impose un couvre-feu à l’ensemble de la population) dans la façon dont il éduque son fils, à coups de poing, de colère et de mots criés. Et, en dernière instance, de la société elle-même, qui, en raison de la guerre et de la menace non explicitée mais permanente de « bandits », se militarise et réduit ses soldats à compter et à retirer les morts pour les entreposer à la morgue. Le dicteur est l’une des nombreuses victimes de ce pays ravagé par la guerre et la crise — deux réalités explicitement mentionnées par lui, sans autre précision référentielle ou spécificatrice, deux réalités proprement universelles dès lors —, mais il n’en est pas moins bourreau lui-même, à sa façon, de son fils, on l’a dit, mais aussi de l’élève qui l’attend à la fin des cours et avec laquelle il entre dans un jeu on ne peut plus dangereux, ambigu et pervers, qui se termine par une agression et une tentative de viol. Si lui, à l’inverse de l’assassin, a su s’arrêter —trop tard quoi qu’il en soit et ayant de toute façon outrepassé les limites de la morale et du consentement—, il n’en demeure pas moins que tout ce qu’il a vécu, tout ce qu’il vit et ses répliques déchirantes sur l’impossible réhabilitation et l’expiation, qui le concernent au premier chef, sont relus et réinterprétés à l’aune de cette absence d’irréprochabilité du personnage.
Que vous a appris ce travail de traduction sur la langue française, mais aussi – peut-être – sur la langue espagnole, et sur vous-même ?
FXG : Ce travail de traduction m’a moins appris sur la langue espagnole ou la langue française, peut-être, à strictement parler, que sur les différences culturelles qu’elles charrient et qui donnent parfois du fil à retordre au traducteur. C’est ainsi que le système d’interlocution entre le père et le fils, puis le professeur et ses élèves, profondément lié aux réalités culturelles de chaque pays, a parfois soulevé quelques doutes (tutoiement, vouvoiement), et, plus particulièrement, et plus décisivement, tout ce qui relève du traitement que le dicteur réserve à son ancien élève, devenu adulte entre-temps, et son élève, adolescente elle. Il a fallu s’interroger sur les gestes de celle-ci envers son professeur, sur ce que pouvaient supposer, dans chacune des aires géographiques, celle de la langue source et celle de la langue cible, les accolades, les embrassades, voire les baisers, et déterminer, avec l’aide de l’autrice, s’il s’agissait de réalités culturelles structurelles ou s’il fallait mettre la chose sur le compte d’une situation fictionnelle singulière et peu représentative.
LG : Je partage l’avis de François-Xavier. C’est essentiellement sur ces questions culturelles qu’a porté notre réflexion. Nous avons tenté une approche qui ne soit ni trop sourcière (au risque de laisser dans le non-dit des éléments relevant de l’évidence pour le spectateur colombien) ni trop cibliste (afin de ne pas annuler la réflexion politique que charrie le texte quant à la réalité colombienne). Mais, comme toujours, on est confronté à des intraduisibles de nature linguistique et culturelle qui nous oblige à être inventifs. Le double sens du terme « dictador » dans la pièce (le « dictateur » mais aussi « celui qui fait des dictées ») nous a ainsi mis dans l’embarras… Ce que l’on apprend généralement de cette impossibilité de traduire, c’est qu’au théâtre le sens se construit aussi dans les béances du texte : ce que la traduction ne parvient pas à dire est souvent présenté, sous d’autres formes, dans la toile de fond dramaturgique de la pièce. Il faut donc faire confiance à celle-ci.
Quel écho pourrait trouver ce texte colombien, selon vous, sur les scènes francophones aujourd’hui ?
LG : Ce texte, ancré dans une réalité colombienne, aborde des questions universelles ayant trait à la banalité de la violence et ses conséquences sur les individus. Sur le plan politique, l’Amérique latine a souvent été un laboratoire politique où se dessine le devenir de nos sociétés occidentales. Il convient donc d’être à l’écoute de ce qui joue dans de l’autre côté de l’océan, qui plus est à une époque où les digues démocratiques sont en train de céder et où la violence et le rapport de force semblent de plus en plus légitimés par certains discours politiques.
FXG : La pièce montre notamment comment l’injustice appelle l’injustice et la violence entraîne la violence. D’une certaine manière, on se demande, à la lecture de la pièce, si la loi du talion (« œil pour œil, dent pour dent) est un remède à la douleur. On peut en douter et c’est là une leçon qu’il nous faut entendre.
Vous aimerez aussi

Vidéo de présentation Mousson d’été
4 janvier 2016
L’Université d’été 2016
4 janvier 2016